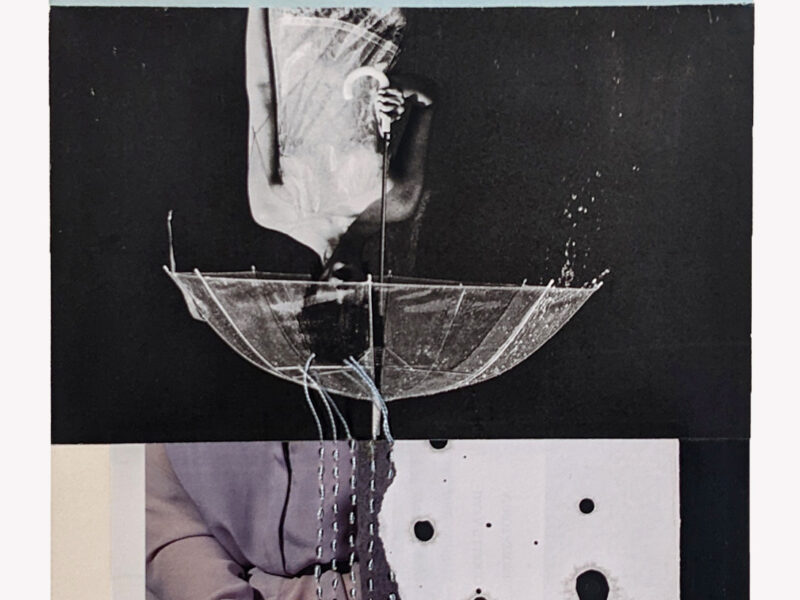Joseph | Les Mots
Karl m’avait retourné comme une peau de lapin: j’avais cru n’écrire que pour fixer mes rêves quandje ne rêvais, à l’en croire, que pour exercer ma plume: mes angoisses, mes passions imaginairesn’étaient que les ruses de mon talent, elles n’avaient d’autre office que de me ramener chaque jour à mon pupitre et de me fournir les thèmes de narration qui convenaient à mon âge en attendant les grandes dictées de l’expérience et la maturité. Je perdis mes illusions fabuleuses: « Ah! disait mon grand-père, ce n’est pas tout que d’avoir des yeux, il faut apprendre à s’en servir. Sais-tu ce que faisait Flaubert quand Maupassant était petit? Il l’installait devant un arbre et lui donnait deuxheures pour le décrire. » J’appris donc à voir. Chantre prédestiné des édifices aurillaciens, je regardais avec mélancolie ces autres monuments: le sous-main, le piano, la pendule qui seraient euxaussi — pourquoi pas? — immortalisés par mes pensums futurs. J’observai. C’était un jeu funèbre et décevant: il fallait se planter devant le fauteuil en velours frappé et l’inspecter. Qu’y avait-il à dire? Eh bien, qu’il était recouvert d’une étoffe verte et râpeuse, qu’il avait deux bras, quatre pieds, un dossier surmonté de deux petites pommes de pin en bois. C’était tout pour l’instant mais j’yreviendrais, je ferais mieux la prochaine fois, je finirais par le connaître sur le bout du doigt; plus tard, je le décrirais, les lecteurs diraient: « Comme c’est bien observé, comme c’est vu, comme c’est ça! Voilà des traits qu’on n’invente pas! » Peignant de vrais objets avec de vrais mots tracés par unevraie plume, ce serait bien le diable si je ne devenais pas vrai moi aussi. Bref je savais, une foispour toutes, ce qu’il fallait répondre aux contrôleurs qui me demanderaient mon billet.
On pense bien que j’appréciais mon bonheur! L’ennui, c’est que je n’en jouissais pas. J’étaistitularisé, on avait eu la bonté de me donner un avenir et je le proclamais enchanteur mais, sournoisement, je l’abominais. L’avais-je demandée, moi, cette charge de greffier? La fréquentationdes grands hommes m’avait convaincu qu’on ne saurait être écrivain sans devenir illustre; mais, quand je comparais la gloire qui m’était échue aux quelques opuscules que je laisserais derrière moi, je me sentais mystifié: pouvais-je croire en vérité que mes petits-neveux me reliraient encore et qu’ils s’enthousiasmeraient pour une œuvre si mince, pour des sujets qui m’ennuyaient d’avance? Je me disais parfois que je serais sauvé de l’oubli par mon « style », cette énigmatique vertu que mongrand-père déniait à Stendhal et reconnaissait à Renan: mais ces mots dépourvus de sens ne parvenaient pas à me rassurer.
Surtout, il fallut renoncer à moi-même. Deux mois plus tôt, j’étais un bretteur, un athlète: fini! EntreCorneille et Pardaillan, on me sommait de choisir. J’écartai Pardaillan que j’aimais d’amour; par humilité j’optai pour Corneille. J’avais vu les héros courir et lutter au Luxembourg; terrassé par leurbeauté, j’avais compris que j’appartenais à l’espèce inférieure. Il fallut le proclamer, remettre l’épéeau fourreau, rejoindre le bétail ordinaire, renouer avec les grands écrivains, ces foutriquets qui ne m’intimidaient pas: ils avaient été des enfants rachitiques, en cela au moins je leur ressemblais; ilsétaient devenus des adultes malingres, des vieillards catarrheux, je leur ressemblerais en cela; un noble avait fait rosser Voltaire et je serais cravaché, peut-être, par un capitaine, ancien fier-à-bras de jardin public.

Je me crus doué par résignation: dans le bureau de Charles Schweitzer, au milieu de livres éreintés, débrochés, dépareillés, le talent était la chose du monde la plus dépréciée. Ainsi, sous l’Ancien Régime, bien des cadets se seraient damnés pour commander un bataillon, qui étaient voués de naissance à la cléricature. Une image a résumé longtemps à mes yeux les fastes sinistres de la notoriété: une longue table recouverte d’une nappe blanche portait des carafons d’orangeade et desbouteilles de mousseux, je prenais une coupe, des hommes en habit qui m’entouraient — ils étaientbien quinze — portaient un toast à ma santé, je devinais derrière nous l’immensité poussiéreuse et déserte d’une salle en location. On voit que je n’attendais plus rien de la vie sinon qu’elle ressuscitâtpour moi, sur le tard, la fête annuelle de l’Institut des Langues Vivantes.

Ainsi s’est forgé mon destin, au numéro un de la rue Le Goff, dans un appartement du cinquièmeétage, au- dessous de Goethe et de Schiller, au-dessus de Molière, de Racine, de La Fontaine, face à Henri Heine, à Victor Hugo, au cours d’entretiens cent fois recommencés: Karl et moi nous chassions les femmes, nous nous embrassions étroitement, nous poursuivions de bouche à oreilleces dialogues de sourds dont chaque mot me marquait. Par petites touches bien placées, Charles me persuadait que je n’avais pas de génie. Je n’en avais pas, en effet, je le savais, je m’en foutais; absent, impossible, l’héroïsme faisait l’unique objet de ma passion: c’est la flambée des âmespauvres, ma misère intérieure et le sentiment de ma gratuité m’interdisaient d’y renoncer tout à fait. Je n’osais plus m’enchanter de ma geste future mais dans le fond j’étais terrorisé: on avait dû se tromper d’enfant ou de vocation. Perdu, j’acceptai, pour obéir à Karl, la carrière appliquée d’un écrivain mineur. Bref, il me jeta dans la littérature par Se soin qu’il mit à m’en détourner: au point qu’il m’arrive aujourd’hui encore, de me demander, quand je suis de mauvaise humeur, si je n’ai pas consommé tant de jours et tant de nuits, couvert tant de feuillets de mon encre, jeté sur le marchétant de livres qui n’étaient souhaités par personne, dans l’unique et fol espoir de plaire à mon grand-père. Ce serait farce: à plus de cinquante ans, je me trouverais embarqué, pour accomplir les volontés d’un très vieux mort, dans une entreprise qu’il ne manquerait pas de désavouer.

En vérité, je ressemble à Swann guéri de son amour et soupirant: « Dire que j’ai gâché ma vie pour une femme qui n’était pas mon genre! » Parfois, je suis mufle en secret: c’est une hygiènerudimentaire. Or le mufle a toujours raison mais jusqu’à un certain point. Il est vrai que je ne suispas doué pour écrire; on me l’a fait savoir, on m’a traité de fort en thème: j’en suis un; mes livres sentent la sueur et la peine, j’admets qu’ils puent au nez de nos aristocrates; je les ai souvent faitscontre moi, ce qui veut dire contre tous , dans une contention d’esprit qui a fini par devenir unehypertension de mes artères. On m’a cousu mes commandements sous la peau: si je reste un jour sans écrire, la cicatrice me brûle; si j’écris trop aisément, elle me brûle aussi. Cette exigence fruste me frappe aujourd’hui par sa raideur, par sa maladresse: elle ressemble à ces crabes préhistoriqueset solennels que la mer porte sur les plages de Long Island; elle survit, comme eux, à des tempsrévolus. Longtemps j’ai envié les concierges de la rue Lacépède, quand le soir et l’été les font sortirsur le trottoir, à califourchon sur leurs chaises: leurs yeux innocents voyaient sans avoir mission de regarder.
Seulement voilà: à part quelques vieillards qui trempent leur plume dans l’eau de Cologne et de petits dandies qui écrivent comme des bouchers, les forts en version n’existent pas. Cela tient à la nature du Verbe: on parle dans sa propre langue, on écrit en langue étrangère. J’en conclus que nous sommes tous pareils dans notre métier: tous bagnards, tous tatoués. Et puis le lecteur a compris que je déteste mon enfance et tout ce qui en survit: la voix de mon grand-père, cette voix enregistrée qui m’éveille en sursaut et me jette à ma table, je ne l’écouterais pas si ce n’était la mienne, si je n’avais, entre huit et dix ans, repris à mon compte dans l’arrogance, le mandat soi-disant impératif que j’avais reçu dans l’humilité.